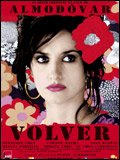En rangeant mes courriels, je trouve cet article du monde envoyé par mon ami Bertrand Laidain. J'ai pensé aussitôt aux
réflexions de samedi de Christian à propos de Handke et de Venise.
Entretien avec Erri de Lucca
"L'écriture est un lieu de villégiature"
LE MONDE | 05.08.05 | 13h14 • Mis à jour le 05.08.05 | 13h14
Dehors, le soleil d'été plonge la campagne romaine dans le silence et l'immobilité. Dedans, c'est la pénombre d'une pièce tapissée de livres. La maison de l'écrivain italien Erri De Luca est une ancienne étable qu'il a aménagée lui-même, du temps où il était maçon. Ancien militant d'extrême gauche, dans les années 1970, Erri De Luca a exercé divers métiers manuels avant de commencer à vivre de ses livres - essais, romans, nouvelles et poèmes au ton singulier, lumineux.
Sans cesse sollicité pour participer à des rencontres, des lectures ou des débats, Erri De Luca est aussi un lecteur et un commentateur passionné de la Bible, un musicien à ses heures et un alpiniste de haut niveau. Mais c'est là, dans cette habitation tout en longueur qu'il revient pour prendre soin de ses arbres, entre deux voyages.
Vous êtes un lecteur assidu de la Bible, depuis les années où vous travailliez comme ouvrier sur des chantiers. Vous avez écrit plusieurs livres de commentaires bibliques, en parallèle à votre oeuvre de fiction. Comment ce livre est-il arrivé entre vos mains ?
Par hasard, au début des années 1980. Je me trouvais alors au nord de l'Italie, dans un centre où je me préparais à aller travailler comme bénévole en Tanzanie. J'apprenais le swahili et les rudiments du travail que j'aurais à faire là-bas. A cette époque, j'étais fatigué des livres et je n'en avais pris aucun avec moi, mais j'ai trouvé une Bible, qui était là, j'ai commencé à la regarder et j'ai aimé cette histoire car elle était désertique : elle ne voulait pas tenir compte du lecteur. Elle l'ignorait. J'avais l'impression d'être obligé de m'éloigner pour aller sur ces lignes comme sur des pistes en plein désert. Le désert est le lieu de la relation entre Dieu et les hommes, dans les Ecritures. Le Seigneur dit aux hommes "Va-t'en", pour les envoyer loin de chez eux, les arracher à leur environnement.
Abraham, Moïse ou David, les premiers prophètes sont des bergers, qui vaguent dans l'immensité solitaire, là où l'ouïe est plus fine, loin du bruit des hommes. Là où l'on est plus disposé à entendre et à retenir. Le lecteur de la Bible doit, lui aussi, se détacher de son point d'ancrage et s'égarer dans le désert, le temps de la lecture. Pour moi, c'était une rencontre magnifique : pouvoir me détacher de ce qui était autour de moi, avant de sortir gaspiller mon énergie sur un chantier, c'était comme une avance. Intouchable, imprenable.
Vous sentiez-vous détaché, vous-même ?
Oui, j'étais seul quand je faisais ce métier d'ouvrier. Il me vidait et me prenait toutes mes ressources. Alors, je cherchais une chose suffisamment forte pour faire contrepoids : les Ecritures en début de journée et mon écriture personnelle à la fin, mais celle-ci n'était que facultative, car l'écriture est, pour moi, exactement le contraire du travail. C'est un lieu de villégiature. Quant aux Ecritures saintes du matin, c'était une question de santé : la satisfaction de remuer dans ma tête des syllabes anciennes, incompréhensibles aux autres, et parfois même de les laisser affleurer sur mes lèvres s'il y avait du bruit à l'extérieur. La joie d'avoir arraché quelque chose à la journée. Je me répétais régulièrement des passages du livre de Néhémie, sur le désespoir des maçons qui reconstruisent le mur de Jérusalem...
Vous manifestez des sentiments ambigus à l'égard de votre époque. Avez-vous l'impression de ne pas en faire partie ?
J'appartiens à cette époque, car j'y habite, mais j'ai aussi le sentiment d'appartenir à d'autres temps. Quand on lit l'Ancien Testament dans sa langue maternelle, en hébreu, comme je le fais, on est contemporain des générations qui ont fait cet exercice de lecture avant nous, qui ont forcé cette révélation avec des mots, avec de l'intelligence. En passant sur la surface de cette écriture, on parvient à se détacher de son propre temps pour faire un tour dans la bouche et dans la tête des anciens.
Comme je ne suis pas croyant, il s'agit seulement d'un passage, avec une entrée et une sortie, correspondant à l'ouverture et à la fermeture du Livre. Le croyant, lui, est un résident du Livre ! C'est avec cette ouverture que je me réveille chaque matin, à 5 heures, et que je prononce mes premières paroles en remuant les lèvres pour dire les mots anciens, même quand je suis seul. Ce livre doit être dit comme ça, car la langue demande à être prononcée. Mikra, qui désigne l'ensemble de ce que nous appelons la Bible, signifie aussi "lecture à voix haute".
Y a-t-il une relation entre la Bible et l'alpinisme, que vous pratiquez à un haut niveau ?
En grimpant, je me procure un désert provisoire. J'entre dans un lieu vide ou très peu fréquenté, un lieu ou je peux jeter un coup d'oeil sur le vide qui nous a précédés - et qui nous succédera, je vous le promets. Là-haut, je me trouve en situation d'hôte, mais pas d'invité. Et j'appartiens un peu moins à ce temps qui a la présomption d'être résident sur terre, d'être le patron de la terre, de l'air et de l'eau. Quand vous pensez qu'on a même inventé la notion d'"eaux territoriales" ! C'est une contradiction dans les termes, les eaux sont extraterritoriales par définition et pourtant, on a tracé des frontières jusque sur elles.
Et puis j'ai des sentiments inactuels, comme celui d'être violemment, substantiellement, de passage. Physiquement, évidemment, à la surface des montagnes, mais aussi sur celles des lettres hébraïques : je m'en tiens au caractère littéral des Ecritures, je n'interprète pas. Je crois que ce texte est à prendre ou à laisser, dans son entier. Je n'aime pas descendre dans les profondeurs du sol ou de la mer : je nage, mais je ne plonge pas. Je suis quelqu'un de surface.
Je me sens tellement de passage qu'en montagne, je ne plante jamais de clou. J'utilise ceux des autres, ça oui, mais jamais je n'ai donné un coup de marteau sur une paroi rocheuse. Et quand j'arrive au sommet, une sorte de pudeur m'empêche d'écrire sur le livre qui se trouve parfois là, pour que les alpinistes laissent quelques mots. Je ne veux pas laisser de trace - seulement celle de mes pas, mais en montagne, la neige a tôt fait de les recouvrir, c'est même l'un de ses dangers.
Pourtant, la littérature est une manière forte de laisser des traces...
Il y a des écrivains qui parlent de leur oeuvre comme de constructions, de bâtiments. Moi, non. Je vois plutôt mes livres comme des passages, des sentiers dans un champ, que quelqu'un peut emprunter à sa guise. Et puis les livres sont des objets, qui finissent par mourir, brûlés, noyés. Pendant le siège de Sarajevo, le poète Izet Sarajlic s'est chauffé avec sa bibliothèque : d'abord les essais, puis les romans et finalement les poèmes. Certains livres restent, bien sûr, mais c'est comme un héritage dont beaucoup serait gaspillé. Nous n'avons qu'une petite partie des vers de Pindare et ceux que nous n'avons jamais lus, nous ne pouvons même pas les regretter. On a perdu des vers de Pindare ? On peut perdre tout le reste !
Pour vous, l'acte d'écrire consiste à ressusciter des morceaux de passé ?
C'est plutôt un moment où je force des absents à être là : des personnes, mais aussi une ville ou une île telles qu'elles étaient autrefois. J'ai le sentiment d'être avec des gens dans le passé. Tout le temps de l'écriture, je deviens le lit de ces rencontres. Je combats l'absence injustifiée des morts, parce que je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne les laisse pas tranquilles là où ils se sont cachés. Je les en extrais et je les oblige à revivre pour un moment. Au fond, je suis un persécuteur d'absents !
Parce que la mort vous paraît un scandale ?
Non, elle fait partie du gaspillage naturel, qui appartient à l'économie de la vie. C'est une sorte de contrepartie de la beauté. Mais je ne veux m'habituer à aucune absence je suis contre. J'admets seulement la mienne. En tant que non-croyant, je sais uniquement qu'un jour on ne s'embrassera plus avec les autres. J'admets ma mort, oui : elle est là.
Parlant de vos livres, vous dites que vous n'inventez pas. Pourquoi ?
J'invente très peu, même si j'aime bien les histoires imaginées par les autres : quand vous trafiquez avec le passé, il n'est pas nécessaire de créer des personnages ou la fin d'un récit, puisque tout est déjà donné. Du coup, je suis toujours à l'intérieur des histoires que je raconte, je ne me soulève pas au-dessus d'elles. Je n'ai jamais écrit à la troisième personne, comme un chef d'orchestre dirigeant ses musiciens : je suis moi-même dans l'orchestre, changeant d'instrument en fonction des livres, tour à tour dans la peau d'un maçon, d'un jardinier, d'un alpiniste. Le chef d'orchestre, c'est la vie qui a produit cette histoire. Et le fait d'inventer des existences me semble un abus de confiance : il en existe déjà tellement, je ne vais quand même pas prendre le vice du Bon Dieu !
En revanche, j'éprouve de la gratitude pour le moment où je me souviens d'un morceau de passé, même si je n'ai pas la clef de cette mémoire : cela m'arrive à l'improviste, par bribes, comme une détonation et j'ai soudain envie de faire durer ce moment. L'écriture de Tu, mio, par exemple, a été déclenchée par la vue d'une femme dont le sourire, qui découvrait une dent ébréchée, m'a rappelé une amie d'adolescence. Je deviens le lieu où le passé fait une petite promenade, passe une deuxième fois. Mais c'est la dernière : il n'y en aura jamais de troisième, car l'écriture a ce pouvoir de s'imposer comme le format définitif d'un moment de vie, sa version officielle, en quelque sorte.
D'une certaine manière, vos livres ne sont-ils pas des actes de résistance au temps ?
Je suis d'un siècle, le XXe, où l'histoire majeure a intensément écrasé les histoires mineures : elle a fait irruption dans la vie des individus, séparant les hommes des femmes, les parents des enfants, les communautés de leurs lieux de vie. Je m'attache à donner de la valeur à ces histoires mineures, celles des gens. Je leur offre toute mon affection. Si bien que, dans mes livres, l'histoire majeure n'est le plus souvent qu'un bruit de fond.
Quand vous avez milité à l'extrême gauche, dans les rangs de Lotta Continua, au cours des années 1970, c'était pour changer le cours de "l'histoire majeure" ?
Ah oui ! Nous sommes devenus des producteurs d'histoire, des fabricants de transformations. Nous étions bien les enfants de notre siècle. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé le mot "communisme" : nous l'avons employé comme étant le plus éloigné de ce qui se passait alors chez nous. Ce qui ne veut pas dire que nous étions fiers de ce qui se faisait là où le communisme était installé au pouvoir. Ma génération n'a pas aimé la Russie de Brejnev. Et moi, je peux dire que je n'ai jamais été un maoïste idolâtre. Au fond, j'aimais Rosa Luxemburg. Je crois que j'aime les personnes qui n'arrivent pas à mourir dans leur lit.
Qu'est-il resté de ces luttes ?
En ce qui me concerne, je ne pouvais rien faire de mieux de ma jeunesse. Je demeure fidèle à cet engagement qui a rempli ma vie, de 18 à 30 ans. Sur le plan concret, il en reste des améliorations obtenues de force sur les lieux de travail, plus de démocratie dans les forces armées, les prisons. Et mon sentiment de n'avoir pas déserté le mot d'ordre, l'appel de ma génération, que j'avais trouvé dans les rues. Du communisme, il est resté la préposition cum, "avec", celle de la fraternité - la plus belle de la grammaire.
Dans d'autres circonstances, par exemple quand je me suis trouvé à Belgrade, en 1999, sous les bombes, je n'ai pas eu le sentiment d'être "avec". J'avais voulu déserter mon pays, qui participait au bombardement de Belgrade, l'activité la plus terroriste qui soit. J'étais seul, au cinquième étage de l'hôtel Moskva, chambre 411, et je restais à la fenêtre quand la sirène antiaérienne retentissait, car j'étais venu là pour être témoin, pour voir ce que faisaient les avions partis une demi-heure plus tôt de mon pays. Mais au lieu d'être cum, j'ai été réduit à une préposition mineure : "dans".
Votre attitude face à la communauté des écrivains est marquée par un certain éloignement. Vous refusez de participer au jeu des prix littéraires, en Italie. Quelle est la raison de ce rejet ?
C'est une communauté qui s'échange des prix et forme un circuit de bénéficiaires dont je ne fais pas partie. Je considère que je reçois beaucoup de prix littéraires dans la rue, chaque fois que quelqu'un m'arrête, me serre la main, me dit quelque chose. Surtout, j'aime les livres, mais pas tellement ceux qui les écrivent. L'auteur ne m'intéresse pas, à l'exception des poètes, dont je voudrais que la vie soit à la hauteur de leurs pages. Même Thomas Mann, cela ne m'aurait pas plu de le rencontrer, d'après ce que je sais de sa vie. Quant à Bohumil Hrabal, peut-être que j'aurais aimé le voir de loin, au bistrot ; mais être assis à sa table, non...
Propos recueillis par Raphaëlle Rérolle
Article paru dans l'édition du 06.08.05
La prose radicale et poétique d'un militant
LE MONDE | 05.08.05 | 13h14
Né à Naples, en 1950, dans une famille de la bourgeoisie, Erri De Luca quitte le domicile familial en 1968 pour rejoindre le mouvement d'extrême gauche Lotta Continua, où il militera à plein temps pendant plusieurs années.
Lotta Continua est dissoute en 1976. Erri De Luca devient ouvrier, notamment chez Fiat, avant d'abandonner la lutte politique et de commencer à travailler comme maçon.
Ses pas l'amèneront en France, sur différents chantiers, mais aussi en Afrique, où il part comme bénévole. En parallèle, il apprend l'hébreu pour lire la Bible et continue d'écrire, comme il le fait depuis l'âge de 20 ans.
Son premier livre, Une fois un jour (Verdier, 1992), est publié en Italie en 1989. Très vite, sa prose radicale, poétique et concentrée trouve un public non seulement dans la Péninsule mais en France et ailleurs.
Depuis il a publié des romans (Montedidio, Gallimard, 2002, lauréat du prix Femina étranger), des nouvelles (Le Contraire de un, Gallimard, 2004) et des récits, mais aussi des recueils de chroniques (Rez-de-chaussée, Rivages, 1996) ou de poèmes (Œuvre sur l'eau, Seghers, 2002) et des commentaires bibliques (Un nuage comme tapis, Rivages, 1994).
Erri De Luca a aussi convoyé des camions de ravitaillement à destination de la Bosnie, pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Alpiniste chevronné, il a participé à deux expéditions dans l'Himalaya.